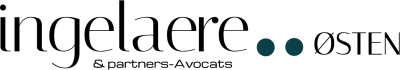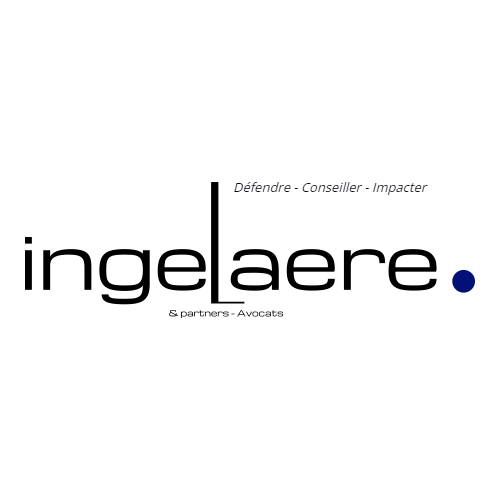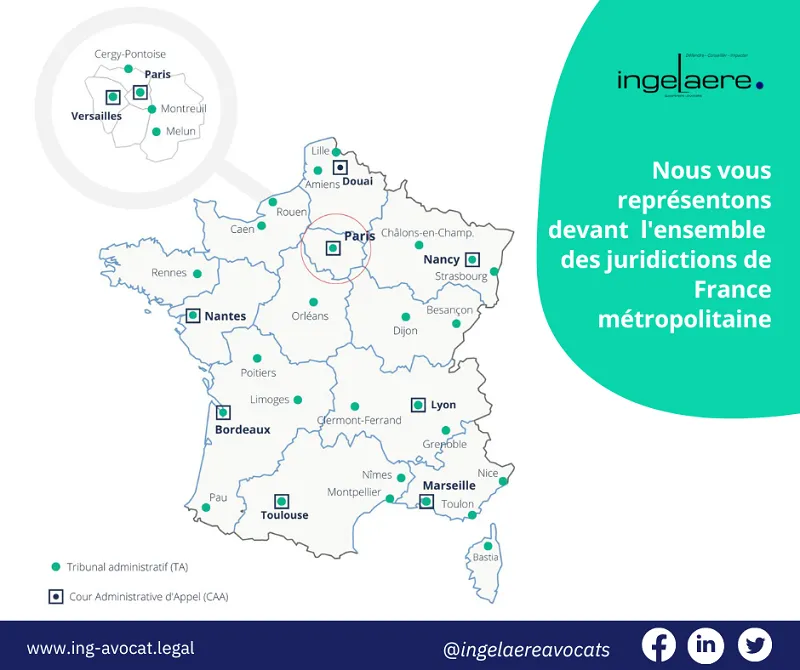Introduction : quand « l’union fait la force »… sauf en droit de l’urbanisme
S’opposer à un projet immobilier qui menace votre cadre de vie est légitime. La tentation première des riverains ? Se regrouper pour « peser plus lourd » face au promoteur. Pourtant, en matière de permis de construire, l’union ne fait pas la force ; elle fait l’enfermement procédural.
Dans cet article, nous allons démontrer, exemples concrets et jurisprudence à l’appui, pourquoi le recours collectif est un piège :
- la procédure devient indivisible ;
- chaque voisin est solidaire des autres, même quand leurs intérêts se retournent ;
- la moindre divergence bloque toute négociation d’aménagement ou d’indemnisation ;
- le risque financier explose en cas de condamnation aux frais irrépétibles (article L.761-1 du code de justice administrative).
Enfin, nous proposerons la stratégie efficace : des recours individuels, coordonnés par un avocat en urbanisme, pour garder la maîtrise de vos droits tout en parlant d’une même voix.
1. Le mirage de la « détermination commune » : une solidarité juridique totale
Un « recours collectif » contre un permis de construire ne repose sur aucun texte spécifique ; il s’agit simplement d’une requête unique au nom de plusieurs requérants. Mais ce choix emporte deux conséquences souvent ignorées :
- Irretraitabilité individuelle : Dès que la requête est enregistrée, tous les requérants sont parties à la même instance (art. R.411-1 CJA). Se désister après coup suppose… l’accord unanime des autres, car le tribunal demandera si l’action doit se poursuivre sans vous. Or un désistement partiel risque de fragiliser l’argumentaire global : les co-requérants s’y opposent presque toujours.
- Indivisibilité des moyens : Le juge apprécie les moyens soulevés dans leur ensemble. Un grief propre à A mais pas à B devient commun, même s’il ne sert pas l’intérêt de B. En pratique, une défense éclatée affaiblit le dossier.
2. Prisonniers jusqu’au bout : l’impossible sortie de secours
Imaginons qu’un requérant veuille se retirer parce qu’il vient de signer un accord de voisinage avec le promoteur. Il devra :
- obtenir l’accord écrit de tous les autres ;
- déposer un désistement partiel qui sera examiné publiquement à l’audience ;
- continuer à assister aux échanges tant que le tribunal n’a pas statué.
S’ils refusent ? L’accord devient caduc, et le voisin se retrouve à combattre un permis qu’il aura pourtant négocié !
À l’inverse, dans un recours individuel, vous gardez la pleine latitude :
- vous désister quand vous le souhaitez ;
- transiger librement (art. L.600-8 CU) ;
- ajuster vos conclusions pour accepter un permis modificatif favorable.
3. L’épée de Damoclès financière : la condamnation solidaire aux frais
Article L.761-1 CJA : le juge peut condamner la partie perdante à verser à la partie gagnante une somme couvrant ses frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment).
En recours collectif, la condamnation est solidaire. Concrètement :
- la société de promotion réclame 5 000 € ;
- le tribunal fait droit à la demande ;
- chaque voisin est tenu pour la totalité tant que les autres n’ont pas payé (art. 1310 C. civ.).
Avec un recours individuel, la somme est, au pire, limitée à vos propres conclusions ; souvent, le juge réduit l’équivalent aux ressources du requérant.
4. Les intérêts divergents : terreau de l’impasse stratégique
4.1 Exemple de la vue plongeante supprimée
Madame X négocie la suppression d’un balcon dominant son jardin ; elle est satisfaite. Messieurs Y et Z veulent toujours faire tomber l’ensemble du projet. Dans le recours collectif, la suppression du balcon n’efface pas l’action : Y et Z imposent la poursuite. Résultat : Madame X perd un accord qui lui convenait.
4.2 Exemple de l’indemnisation inégale
Un promoteur propose à chaque riverain 10 000 € pour compenser la perte d’ensoleillement. Monsieur A accepte ; Madame B considère que son préjudice vaut 20 000 €. Sans unanimité, personne ne touche un centime et la procédure s’éternise des années.
4.3 Exemple de la hauteur modifiée
La mairie suggère de rabaisser le bâtiment d’un niveau. Deux requérants jugent l’ajustement suffisant ; trois autres s’y opposent. Le projet amendé reste bloqué, l’investisseur retire sa proposition… et tout le monde recommence à zéro.
5. L’argument juridique : indivisibilité et solidarité procédurales
Dans son arrêt CE, 20 octobre 2023, n° 461 887, le Conseil d’État rappelle que « le désistement de l’un des co-requérants n’emporte pas nécessairement désistement des autres, sauf accord exprès ». Mais surtout, il précise que l’indivisibilité des conclusions peut conduire le juge à rejeter le désistement ou à statuer pour l’ensemble.
Lisibilité :
- le collectif ne peut pas scinder les demandes selon les besoins de chacun ;
- si le promoteur dépose un permis modificatif, tous doivent se positionner à l’unisson (CE, 9 juil. 2021, n° 443 986).
Cet enchevêtrement judiciaire se traduit souvent par des délais doublés (18 à 36 mois), contre 12 à 18 mois pour un recours individuel bien conduit.
6. Pourquoi le recours individuel est-il plus puissant ?
- 1. Personnalisation des moyens : Vous invoquez des atteintes propres : perte d’ensoleillement, atteinte à la vue, empiètements, non-respect de l’article R.111-17 CU, etc. Ces griefs concrets, chiffrés, parlent au juge.
- 2. Flexibilité tactique : Votre avocat peut accepter un permis modificatif qui supprime la fenêtre litigieuse ou réduit la hauteur du pignon. L’accord met fin à la procédure en quelques semaines.
- 3. Risque financier borné : En cas de rejet, la condamnation aux frais d’avocat de l’adversaire est limitée à votre seule instance. Souvent, le juge estime équitable de laisser chaque partie supporter ses frais (jurisprudence constante).
- 4. Force de frappe groupée malgré tout : Plusieurs recours individuels, déposés le même jour par le même cabinet, s’instruisent en parallèle. Le tribunal peut les joindre pour statuer, mais chacun garde son autonomie. Si un voisin se retire, la procédure continue pour les autres sans blocage.
7. La fausse économie des honoraires partagés
On croit parfois qu’un recours collectif va « diviser la note ». C’est oublier que :
- le travail d’analyse urbanistique (plans, PLU, servitudes, covisibilité ABF, étude d’impact) est identique qu’il y ait un requérant ou cinq ;
- les frais irrépétibles adverses sont démultipliés en cas de défaite.
Exemple chiffré :
| Scénario | Honoraires initiaux | Condamnation possible | Coût total par foyer |
|---|---|---|---|
| Recours collectif (5 voisins) | 5 000 € TTC | 5 000 € L.761-1 CJA | 2 000 € |
| Recours individuel (5 voisins) | 2 000 € TTC chacun | 1 000 € max | 3 000 € (si rejet) ou 2 000 € (si gain) |
Autrement dit, miser sur la mutualisation peut aboutir à un coût supérieur, surtout quand l’issue est incertaine.
8. Stratégie gagnante : cinq étapes pour un front coordonné… sans se passer la corde au cou
- 1. Réunion d’information (J-15 à J-10) : L’avocat explique les enjeux, liste les pièces (affichage, certificat d’urbanisme, plans). Chaque voisin décide librement de la suite.
- 2. Diagnostic individualisé (J-10 à J-5) : Pour chaque parcelle, on établit les atteintes propres (ombre portée, servitude de vue, emprise au sol, nuisances chantier).
- 3. Recours individuels synchronisés (J-5 à J) : Dépôt des requêtes le même jour, même cabinet, mêmes moyens juridiques généraux + griefs spécifiques. La cohérence impressionne le juge, sans enfermer les requérants.
- 4. Comité de suivi (J + 1 à J + 12 mois) : Réunions mensuelles pour partager les positions, décider d’accepter ou non des amendements. Chaque voisin reste libre de signer un protocole.
- 5. Sorties de crise modulaires : Acceptation d’un permis modificatif (art. L.600-5-1). Désistement amiable contre indemnité. Poursuite de l’action jusqu’à l’annulation totale si nécessaire.
FAQ – Recours individuel vs collectif : vos questions, nos réponses
Un seul recours, n’est-ce pas plus « lisible » pour le juge ?
Le juge apprécie la qualité des moyens, pas le nombre de dossiers. S’il y a connexité, il peut joindre les affaires ; l’effet lisibilité est obtenu sans solidarité.
Et si nous voulons quand même partager les frais ?
Vous pouvez signer une convention de répartition privée des honoraires, sans pour autant déposer une requête unique. Ainsi, vous gardez chacun votre liberté procédurale.
Le promoteur peut-il jouer la division ?
Oui, mais c’est déjà le cas dans un collectif : il ciblera la faiblesse d’un requérant pour négocier séparément et bloquer les autres. Avec des recours individuels, chacun contrôle la négociation.
Combien de temps dure la procédure ?
En première instance, 12 à 18 mois pour un recours individuel. Collectif : ajoutez 6 à 9 mois de délais (audience reportée, expertise commune, etc.).
Nous sommes en zone de covisibilité ABF : la démolition risque d’être ordonnée. Le recours individuel nous protège-t-il ?
Il protège surtout votre possibilité de transiger avec la commune ou le promoteur pour un permis modificatif compatible ABF, sans attendre que les autres se décident.
Conclusion : la liberté n’a pas de prix… surtout en contentieux de l’urbanisme
Choisir un recours collectif contre un permis de construire, c’est abdiquer votre autonomie :
- vous vous exposez à la tyrannie de la majorité (ou de la minorité bruyante) ;
- vous prenez le risque d’une condamnation solidaire ;
- vous perdez toute marge de négociation.
À l’inverse, le recours individuel :
- sécurise vos intérêts propres ;
- reste coordonné pour peser sur le promoteur ;
- ouvre la porte à des accords sur-mesure ou à un désistement rapide si la situation évolue.
En urbanisme, la meilleure défense est personnalisée, stratégique et flexible. Avant de signer une requête collective, demandez-vous : suis-je prêt à lier mon avenir procédural à celui de mes voisins pendant trois ans ? Si la réponse est non, optez pour la solution la plus intelligente : un recours individuel, accompagné par un avocat rompu aux subtilités du code de l’urbanisme.